C’est sous la menace de l’imposition des tarifs douaniers, que les transformateurs de produits marins se préparent au Seafood Expo North America, qui aura lieu à Boston dans deux semaines.
Le plus grand salon de commercialisation de produits marins en Amérique du Nord, qui aura lieu les 15 et 16 mars, reste encore le principal lieu d’affaires pour la vente des produits marins du Québec.
Et selon le directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), Jean-Paul Gagné, les négociations qui se déroulent entre acheteurs et vendeurs seront encore plus importantes si Donald Trump va de l’avant avec l’imposition de tarifs douaniers.
Le conseiller senior en exportation à Gimxport, André-Pierre Rossignol, confirme d’ailleurs qu’il n’y a pas l’ombre d’un mouvement de boycottage du Salon.
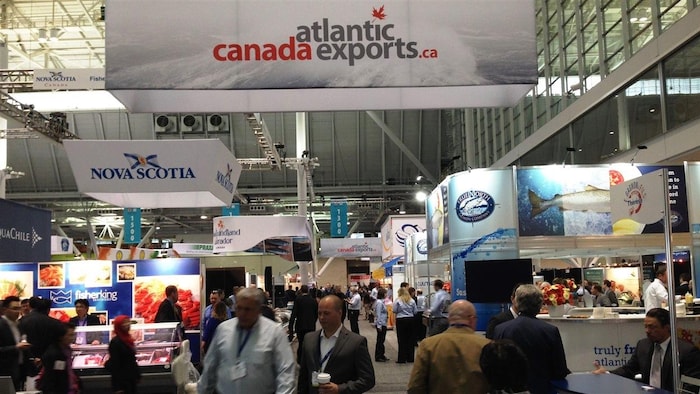
Les entreprises de l’Atlantique au salon Seafood Expo North America, à Boston. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Michel Nogue
À quelques jours du 4 mars, date où les tarifs doivent être imposés, le président de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche, Olivier Dupuis, espère encore que les produits alimentaires soient exemptés des tarifs douaniers américains, mais se prépare au pire.
Il est difficile à un mois d’avis de diversifier les marchés
, relève Olivier Dupuis qui est aussi directeur général de l’usine Pêcheries gaspésiennes de Rivière-au-Renard.
D’autant plus que le marché de Boston est fréquenté depuis des décennies par les propriétaires d’usines de transformation qui, en Gaspésie, sont généralement des entreprises familiales ou de propriétés locales. Boston, décrit Olivier Dupuis, c’est là qu’on rencontre tous nos fournisseurs, tous nos clients. Ce n’est pas seulement les gens des États-Unis, ce sont des gens de partout dans le monde. Tout le monde est présent.
Les ventes vont continuer, mais… ce sera difficile, avoue Jean-Paul Gagné. Ce dernier rappelle que les quantités vendues, des milliers de livres, ne donnent pas beaucoup de latitude aux usines, mais que les produits restent en demande. Il faut que la rencontre se fasse. Je pense qu’ils ont quand même un grand besoin.
La demande pour les produits marins, notamment le homard et le crabe des neiges, reste d’ailleurs assez élastique, selon Pierre-André Rossignol. C’est un produit de haut de gamme et certains clients vont être prêts à payer le pourcentage de plus que ça prend pour en avoir.
Malgré tout, quelque part, il y a quelqu’un qui doit le payer ce 25 %
, explique M. Rossignol. Et sans doute, ajoute-t-il, le vendeur devra en assumer une partie.
Comme Pierre-André Rossignol, M. Dupuis croit que les consommateurs américains vont payer un peu de la facture, mais les transformateurs vont écoper. On s’y attend
, admet M. Dupuis.
Des entreprises du Grand Gaspé surveillent aussi la situation attentivement.

L’usine de transformation de crevette Marinard importe maintenant de la crevette de Norvège. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares
Marinard et Crevette du Nord Atlantique ont dû, l’an dernier, rapidement trouver une nouvelle source d’approvisionnement après l’effondrement des stocks de crevettes nordiques et la baisse dramatique des captures autorisées.
Pour conserver les emplois et l’expertise, les deux usines importent des crevettes de Norvège et les transforment pour le marché américain. Si nous, on arrive avec de la crevette qui a des tarifs et qu’ils [les Européens] n’ont pas de tarifs, mais c’est facile de comprendre que les acheteurs n’achèteront pas la nôtre
, commente le président de l’AQIP.
La morue salée et séchée, le flétan frais font aussi partie des ressources qui risquent d’être touchées.
Les industriels alertes
Normalement, à ce moment de l’année, à quelques semaines de la prochaine saison de pêche, il ne reste pas grand-chose de l’année précédente dans les entrepôts.
Cette année, il reste encore moins de choses. Il y a eu du mouvement de marchandises avant l’imposition des potentiels tarifs, ce qui restait comme inventaire, qui était déjà prévu pour les États-Unis, ça a déjà probablement dans bien des cas transportés pour passer les douanes avant la date fatidique.
Sans surprise, ces mouvements confirment les inquiétudes des entreprises. M. Dupuis observe que les poissons et fruits de mer représentent seulement 5,1 % des exportations du Canada vers les États-Unis. C’est peu pour eux, mais beaucoup pour nous.
Le Québec demeure de plus un très petit joueur comparativement à l’Atlantique, même si ses produits marins sont recherchés.
En termes de volumes, ce n’est pas nous qui allons dicter la valse.
Comme ce fut le cas au cours des années précédentes, les usines comptent sur un taux de change favorable aux exportations pour amortir le choc tarifaire. On peut penser qu’avec l’imposition de tarifs, le taux de change de la valeur du dollar canadien baisserait, donc ça viendrait un peu compenser une partie de ces tarifs.
Un transfert délicat
En Gaspésie, les ententes entre les transformateurs de produits marins et les acheteurs américains existent depuis des années. Faire des affaires aux États-Unis, indique Pierre-André Rossignol, c’est relativement facile. On a une culture qui est très similaire. On peut faire des affaires sur une poignée de main.
En Asie, notamment au Japon, établir des relations demande beaucoup de temps, voire des années. Il faut démontrer qu’on est là pour rester et quand ça changera dans quatre ans, qu’on ne va pas encore disparaître
, prévient le conseiller en exportation. On doit s’adapter à ces différences culturelles là.

Camion des Pêcheries Bertrand Desbois sur le quai de Matane. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé
L’Amérique reste toujours le marché le plus proche et le moins coûteux en transport. On est voisins. Il n’y a pas toute la logistique, au lieu de partir mettre des conteneurs sur des bateaux, on peut y aller directement en camion. Les vieilles pantoufles sont confortables
, convient Olivier Dupuis.
L’écueil pour les entreprises est de se retourner vers leur marché historique dès que les embûches s’estompent sur le marché américain. Finalement, on risque de brûler des ponts. Il faut être prudent avec nos façons de faire
, conseille Pierre-André Rossignol.
Il y a une grande réflexion qui s’impose
, admet par contre le président de l’AQIP. On est quand même un peu présent partout dans le monde, mais il faut faire en sorte qu’on le soit encore moins. Avec ce qui arrive, on en a pour quatre ans, ça va faire en sorte qu’on va encore plus en mode diversification de marché.
Le marché européen
Avec 5,5 % de l’ensemble de ses exportations internationales de produits de la mer, l’Union européenne (UE) était en 2023 le troisième marché d’exportation du Canada, loin derrière la Chine (19 %) et les États-Unis (64 %).
Dans l’ensemble du Canada, outre le homard, les Européens s’intéressent surtout à la crevette nordique et aux pétoncles, deux pêcheries beaucoup plus marginales que peuvent l’être celles du homard et du crabe des neiges.

Les entreprises de pêche sont souvent des entreprises familiales et travaillent avec des acheteurs américains depuis des années. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat
Actuellement, tout le monde regarde ailleurs en même temps. Pas seulement le Québec. Les entreprises du Canada Atlantique aussi, observe le conseiller en exportation, donc ça fait beaucoup de monde en même temps qui va tenter de rallumer des contacts et des liens avec d’autres pays.
La signature de l’Accord économique et commercial global Canada (AECG) entre le Canada et l’UE aide un peu plus puisque depuis le 1er janvier dernier, le Canada bénéficie d’un accès en franchise de droits sur les produits de la mer. Ç’a aidé à rendre nos produits plus compétitifs face à des produits substituts entre autres. Ça aura permis à nos entreprises de négocier de meilleures ententes gagnant-gagnant avec leurs clients existants et de nouveaux prospects.
L’Europe n’est pas un marché facile à ouvrir, même si des pays s’intéressent beaucoup à certains produits. C’est le cas notamment de l’Espagne qui achète du homard gaspésien en bonne quantité.
Il y a de l’intérêt, estime Jean-Paul Gagné, qui rapporte avoir été approché récemment par un distributeur français.
Cependant, les Européens connaissent peu et consomment moins le crabe des neiges qui est, en ce moment, en Gaspésie, vendu à 90 % aux Américains. Transporter ce volume là, ailleurs, ça risque d’être un bon défi, donc ça va être quelque chose qui va se faire graduellement
, commente André-Pierre Rossignol.
Percées gaspésiennes
Les Gaspésiens arrivent dans un marché très normé qui compte déjà beaucoup d’espèces sur le marché et de grands groupes industriels.

Même si la morue n’est plus séchée sur des vigneaux, la Gaspésie exporte encore beaucoup de morue salée séchée aux États-Unis, mais aussi en Europe. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada/Hélène Raymond
Pêcheries gaspésiennes vend déjà de la morue salée et séchée en Europe. Le turbot était aussi un de ses produits d’exportation vers l’Europe, mais sa quasi-disparition amène l’usine à promouvoir d’autres produits, notamment ceux fumés à chaud et fumés à froid.
Au cours de la dernière année, l’entreprise a aussi tenté d’introduire sa production de sébaste. Il y a de l’ouverture, ce n’est pas facile
, note Olivier Dupuis qui demeure optimiste et croit qu’il y a une place pour les produits gaspésiens, compte tenu de leur qualité.
Une des principales vitrines pour se faire voir est le grand marché mondial de fruits de mer de Barcelone, qui se tient au début mai.
Pour les Gaspésiens, c’est en pleine saison de crabe des neiges et à quelques jours de la fête des Mères, soit au pic de la saison du homard pour les Gaspésiens. Les entreprises n’ont pas la tête à aller vendre le produit de l’année prochaine, ils sont plus préoccupés par celui qu’ils sont en train de vendre dans l’année
, explique André-Pierre Rossignol.
C’est d’ailleurs la brièveté de la saison des obstacles à la commercialisation du crabe des neiges sur d’autres marchés que les États-Unis. L’essentiel de la pêche se déroule sur six semaines, au printemps. La saison est courte, les volumes sont grands. En pleine production ce n’est pas nécessairement le meilleur moment pour commencer à faire des initiatives de penser à le vendre ailleurs.
Néanmoins, plusieurs entreprises tentent tout de même d’être présentes à Barcelone. Cette année, l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP) y aura un kiosque pour la première fois.
Des représentants commerciaux d’industriels des trois régions de l’Est-du-Québec y seront présents. Se diversifier dans un temps très limité comme actuellement ce n’est pas simple, indique Jean-Paul Gagné, mais à l’avenir, on pourra se préparer.
Option Asie
Pierre-André Rossignol explique que les Asiatiques sont surtout friands de homard vivant.
Les Gaspésiens rêvent d’ailleurs de disposer des équipements nécessaires à l’exportation par avion-cargo de produits de la mer frais, comme leurs voisins en Atlantique, notamment à Halifax où les vols vers Séoul sont fréquents.

Le crabe des neiges a déjà été exporté principalement au Japon. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon
La piste, l’aérogare et les équipements de l’aéroport du Rocher-Percé, à Grande-Rivière, viennent d’être modernisés, mais il manque toujours un élément pour permettre l’exportation de homard vivant vers l’Asie.
Il faut dans un premier temps faire un arrêt de l’aéroport de Montréal, indique M. Rossignol, et il n’y a pas de vivier. Il manque un petit morceau de robot. Si notre avion arrive à Montréal, puisque l’avion, qui transporte nos homards, a un retard ou un problème technique, on reste pogné avec des hauts sur la piste. Ça prend un plan B sur place.
Quant au crabe des neiges, l’embargo américain sur le crabe russe en raison de la guerre en Ukraine a bouleversé le marché.
Les Russes pour pallier les ventes américaines se tournent maintenant vers l’Asie, notamment la Chine. Notre produit est de meilleure qualité, observe le conseiller de Gimxport, mais ça devient difficile de compétitionner avec un produit qui est souvent beaucoup moins cher.
Jean-Paul Gagné rappelle néanmoins qu’il y a quelques années, le principal marché d’exportation du crabe des neiges était le Japon.
LA UNE : Foire commerciale de produits de la mer à Boston. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé
PAR





